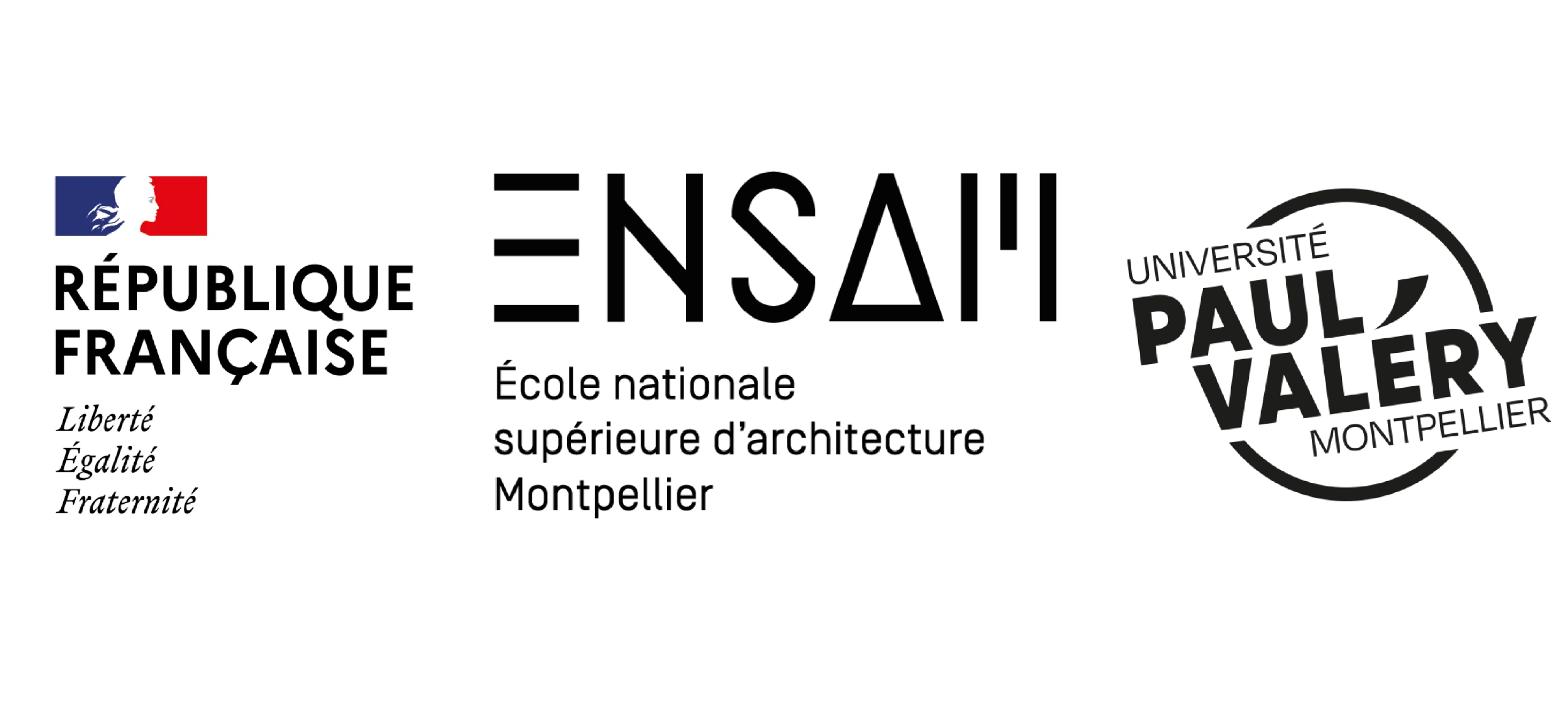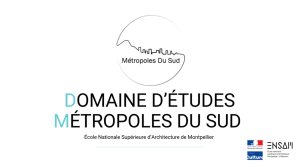En cycle master, le programme pédagogique propose six domaines d’études, deux stages obligatoires et des actions personnelles. Ce cycle de 2 ans conduit au Diplôme d’État d’architecte (DEA) conférant grade de Master.
Des possibilités de parcours sont offertes : double cursus architecte/ingénieur, double diplôme avec deux Universités partenaires en Espagne (ETSAV, UPC Barcelone et UPV/EHU, San Sebastian).
En master, la priorité est donnée à l’acquisition par les étudiants d’une maîtrise du projet architectural et urbain. Chaque domaine d’études organise les enseignements qui sont dispensés dans le bloc « Projet conception » et le bloc « Cultures recherche ». Ceci sous forme de cours magistraux, d’encadrement en atelier de projet, atelier de recherche, de workshops, de travaux dirigés et de travaux pratiques.
En plus d’un domaine d’études, les étudiants en Master 1 peuvent choisir un enseignement obligatoire du bloc « Pro métiers » parmi les thèmes suivants :
- Maîtrise d’œuvre opérationnelle
- Chantiers de réhabilitation, architecte du Patrimoine
- Métiers de l’urbain et paysage
Le bloc « Parcours insertion » est composé des stages et des actions personnelles, langues vivantes.
Le programme pédagogique est identique pour le master en formation initiale et en formation professionnelle continue.
Domaines d'études de Master au choix :
Double-Diplôme Barcelone
Le Domaine d’Études de Master (DEM) « Double-Diplôme Barcelone » s’inscrit dans le cadre de la convention établie en 2024 entre l’ENSAM et l’ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès), une des deux écoles publiques d’architecture de Barcelone.
Tous les étudiants français du DEM suivent le parcours du Double-Diplôme (DD), et intègrent un groupe mixte avec un nombre équivalent d’étudiants espagnols. Ce groupe bi-national est accueilli sur les deux sites avec une logique d’alternance semestrielle : en S7 et S9 il se trouvera à Barcelone, en S8 et S10, à Montpellier.
Le DD propose de profiter des points forts de chaque école, pour les rendre complémentaires : d’un côté, des compétences techniques (notamment celles concernant le développement durable) de l’ETSAV ; de l’autre, de l’expertise en recherche (et sa volonté de l’ancrer au projet) du master de l’ETSAV. Tous les étudiants obtiennent, en fin de S10, les deux diplômes d’état d’architecte, le français et l’espagnol.
Plutôt que de s’axer sur des thématiques concrètes, le parcours prévoit un arpentage du territoire trans-frontalier commun : celui délimité, au Nord, par les bouches du Rhône ; au Sud, par le delta de l’Èbre ; et, dans l’arrière pays, par la première chaîne montagneuse parallèle à la côte.
Les sujets à traiter se déclineront donc des enjeux actuels propres à cette bio-région. Ils nourriront autant les ateliers de projet que de recherche, et se situeront sur une diversité de milieux : qu’ils relèvent autant d’un caractère métropolitain, que patrimonial, rural, littoral… ou de haute montagne. Tout en se sachant enclavés sur un climat et une culture constructive méridionaux.
Du point de vue méthodologique, le DD prévoit l’articulation de son parcours autour de la colonne vertébrale que suppose la séquence progressive des différentes phases de l’atelier recherche (S7, S8 et S9).
Ces ateliers, encadrés par des enseignants des deux nationalités, ont deux objectifs : le premier, nourrir avec de la connaissance théorique les ateliers de projet ; le second, accompagner les étudiants sur l’élaboration d’un mémoire de master (commun aux deux écoles), qui servira de base thématique problématisée pour leur Projet Fin d’Études (PFE). Les deux travaux sont soutenus en fin de S10 à Montpellier, et devant un jury mixte des deux écoles.
DomestiCITÉ
Ce domaine d’études porte sur l’impact de l’usage et le rite dans la spatialité domestique et les relations entre la sphère domestique et la fabrique de la cité. La méthode pédagogique repose sur une pratique à visée théorique via le studio et une théorie à visée pratique par le Séminaire. Chacune constitue une facette de ce que nous appelons une recherche opérationnelle. Le Studio exerce une pratique à portée théorique, car il contient les germes d’un engagement quant à la manière de concevoir un bâtiment. En définissant la théorie comme « Manière de concevoir un bâtiment », Lucan la rend indissociable de l’acte du projet. Le Séminaire est une théorie à visée pratique, car sa dimension critique réside dans la confrontation avec la pratique.
Les problématiques portées par le DEM :
- Comment le logement collectif constitue-t-il une matière première de la ville ? Comment l’ancrage domestique fait-il cité ?
- Que nous apporte l’héritage d’une approche typomorphologique ? Comment le dépasser et le réinterroger aujourd’hui et pourquoi ?
- Comment réinterroger les processus urbains dominés par la rentabilité ?
Les contextes qui intéressent le DEM :
- L’horizon méditerranéen
- La spatialité de l’univers domestique
- Les tissus urbains porteurs d’enjeux prioritaires (devenir des Grands Ensembles, mutation des faubourgs et autres marges)
- Les interventions dans l’existant (réhabilitation, transformation, renouvellement urbain)
Structuration pédagogique :
- Continuité des semestres S7/S8 et S9/S10
- Le séminaire : une approche théorique à visée opérationnelle
- Le studio : une approche pratique à visée théorique
- Le mémoire : une initiation à la recherche
- Le stage Atlas typologique : la mémoire d’un héritage
Spécificité de l’approche pédagogique :
- Les différentes graphies du projet comme modalités exploratoires
- Les méthodes de conception qui passent par l’expérimentation (soufflerie, simulation thermique et d’éclairement) et aux méthodes de diagnostic de terrain
Les spécificités de l’équipe enseignante :
- Une expertise liée au logement collectif
- Une expérience professionnelle et une pratique de la recherche. Elle porte les mêmes engagements sur le terrain professionnel que dans la recherche et les processus exploratoires.
- Des compétences complémentaires (architecture, paysage, structure, ambiance, théorie…)
Métropoles Du Sud
Le domaine d’études Métropoles du Sud s’inscrit dans une réflexion globale sur l’avenir des villes, en affirmant que la métropole constitue aujourd’hui un terrain privilégié pour répondre aux défis contemporains. Alors que 70 % de la population mondiale vivra en zones urbaines d’ici 2050, il devient impératif de penser l’architecture et l’urbanisme dans une perspective écologique, sociale et culturelle renouvelée.
Notre pédagogie repose sur une conviction forte : pour agir sur un environnement global, il faut partir de situations locales et concrètes. Nous travaillons la « ville sur la ville », et l’engagement environnemental est au cœur du projet : les villes, responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre, doivent devenir des leviers de transition. Métropoles du Sud intègre ainsi la lutte contre l’artificialisation des sols, la gestion des ressources locales et l’adaptation aux vulnérabilités climatiques comme axes structurants de son enseignement. Les thématiques explorées — ville post-carbone, ville nature, ville extrême, encore de la régénération urbaine dans des contextes patrimoniaux sensibles, traduisent cette volonté de concevoir des milieux urbains résilients et durables.
Un pilier de cette pédagogie repose sur le décalage du regard : les voyages d’étude et l’exploration de territoires étrangers sont conçus comme de véritables learning experiences. Travaillant selon des cycles, en 2022-23, nous avons amorcer une approche selon l’axe thématique “Métropoles de Proximité” de Athènes à Naples, en passant par Palma de Majorque. Ces immersions permettent aux étudiants de se confronter à des situations urbaines variées, de développer un regard critique et sensible, et d’apprendre à réinterroger leurs propres référentiels. Comprendre la diversité des réponses urbaines à travers le monde nourrit une intelligence collective et ouvre des pistes d’action innovantes face aux enjeux socio-environnementaux.
La pédagogie privilégie l’expérimentation et l’innovation, mobilisant la recherche, la mise en récit, la stratégie prospective et de design-fiction pour former des architectes capables d’affronter l’incertitude et de développer des visions critiques du futur urbain. L’interdisciplinarité, l’hybridation des pratiques et l’ouverture à d’autres territoires renforcent cette posture d’agilité et de responsabilité.
Métropoles du Sud se positionne comme une plateforme de formation et de recherche qui fait de la complexité urbaine un terrain d’apprentissage privilégié. Son ambition est de former des architectes conscients, capables d’agir sur les transitions écologiques et sociales, et de contribuer à la construction de métropoles inclusives, innovantes et respectueuses de leurs contextes.
Enseignant(e)s :
Elodie NOURRIGAT, PR, TPCAU, Architecte, Docteur
Jacques BRION, PR, TPCAU, Architecte
Laurent DUPORT, MCF TPCAU, Architecte
Pierre SOTO, MCF TPCAU, Architecte
Cédric TORNE, MCF, ATR, Artiste
Axelle BOUDEAUX, Ens CDI, TPCAU, Architecte
Faustine CHAIGNAUD, Ens TPCAU, Architecte
Adrian GARCIN, Ens TPCAU, Architecte
Catherine CECCHI, Ens CDD, SHS
Guillaume GIROD, Ens CDD, TPCAU, Architecte HMONP
Davia DOSSI PERLA, Directrice ALBA Conseil & stratégie, PhD Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Ens SHS
- Cliquez ici pour retrouver une vidéo de présentation du domaine d’étude 2025-2026
Situation-S
Les situations renvoient aux réalités de terrain et aux situations de projet que nous inventons, elles sont toujours inédites. Elles prêtent toute leur attention aux usages, aux habitants et aux relations avec l’environnement. L’architecture située se pense au sein de l’école et en dehors, dans un travail d’allers et retours entre immersion et distanciation. Aussi, nous privilégions des sites et situations proches de l’école afin de s’y rendre régulièrement, s’y faire une place et y agir.
L’objectif pour l’étudiant est de construire sa place, non seulement en termes professionnels, mais aussi politiques et sociaux. “Faire” et “éprouver”, considérées ensemble ou dans leur interaction, forment ce que Dewey nomme justement une “situation”. Les étudiants sont ainsi invités, entre travail de projection-conception et réflexivité, à reconsidérer le regard qu’ils portent sur un territoire et des projets, les valeurs données, et à être attentifs aux “pratiques faibles” et émergentes.
L’école et son cadre organisationnel, deviennent une situation pédagogique que les étudiants sont invités à co-construire par leur action et expérience. Les transitions, notamment écologiques, nécessitent de s’appuyer sur une transmission de savoirs, de rapport entre enseignants et étudiants, et de la place de l’expertise dans la transformation des territoires et des situations. Il s’agit de fonder une écologie des relations, des savoirs et des actions, redéfinissant les positions de l’étudiant, de l’enseignant et engageant un rapport direct avec le “réel”: agir et apprendre en même temps. C’est une pédagogie qui (re)pense l’action et le savoir.
Le domaine présente une équipe pluridisciplinaire avec un fonctionnement fort autour du principe du binôme encadrant. Tous les champs disciplinaires sont représentés (TPCAU, AVT, SHS-A, STA, HCA, ATR). Un(e) artiste-chercheur corpographe en résidence complète l’équipe.
Architecture et territoires méditerranéens - Vers une architecture située
Le Domaine « Architecture et territoires méditerranéens – Vers une architecture située » a pour objectif de proposer un parcours défini par une culture du projet sensible au contexte et au milieu dans lequel elle s’inscrit. La pédagogie s’oriente vers un apprentissage qui interroge la relation entre architectures et paysages méditerranéens au sens large du terme. L’idée est de construire un parcours de deux ans qui viendra embrasser toutes les échelles de réflexion et de conception.
Si la sensibilité du domaine s’inscrit en premier lieu dans la ruralité, les territoires des rives méditerranéennes et les grandes agglomérations urbaines qui jalonnent l’environnement géographique et culturel de l’école sont abordés. La volonté est de traiter l’ensemble du territoire méditerranéen. À travers l’étude et la compréhension d’un milieu spécifique, probablement dans la région Occitanie, l’idée est de proposer un regard et une culture du projet qui enlace toutes les échelles de conception et de composition. Du trottoir au territoire et du meuble à l’immeuble. Une approche de l’architecture qui pourrait s’inscrire dans une forme de régionalisme critique, mouvement défini par Kenneth Frampton, historien de l’architecture.
Embrasser simultanément les aspirations progressistes et universalistes du mouvement moderne et faire corps avec le contexte (social, culturel, géographique) dans lequel s’inscrit l’architecture. Pour cela, le lien inextinguible entre les deux champs culturels que représentent l’architecture et le paysage est renforcé.
Au sein du domaine, une compréhension et une analyse du milieu étudié est l’une des prérogatives à la mise en place du projet. Dans le rapport au site et à l’édifice, est interrogé un grand nombre de disciplines (la géographie, le paysage, la géologie, la biologie, la sociologie, l’art de construire, l’histoire et la théorie de l’architecture de la Renaissance à l’époque contemporaine … et bien d’autres choses encore …). Un ensemble de références (paysage, espace public, architecture, mobilier) viennent compléter la démarche de projet dont le point d’équilibre se situe entre tradition et modernité. L’acte de construire est appréhendé comme un élément essentiel dans le développement de cette pensée.
Que le choix du sujet soit inscrit dans la ruralité ou en milieu urbain, l’expérience par le corps semble essentielle dans la compréhension d’un territoire et d’un milieu. Une première séance in situ se développe sur plusieurs jours et vient introduire les problématiques à développer durant le semestre. Dessiner, c’est penser. Concevoir un projet, c’est aussi raconter une histoire, construire un scénario. Chaque étudiant est accompagné dans le développement d’une écriture et d’un vocabulaire du projet qui viendra également se nourrir de son expérience personnelle et de la relation qu’il entretient avec le monde qui l’entoure.
La finalité de ce processus d’apprentissage est de donner la possibilité à chacun, d’aborder le projet à travers deux cultures fondamentales, parallèles et indissociables de la capacité à “Faire œuvre”: celle de l’expérience et du vécu et celle de l’emprunt, du savoir, et de la théorie.
DEM alt-Zéro
Le DEM alt-ZERO est le lieu d’une offre de formation permettant aux étudiants qui le souhaitent de se construire une trajectoire personnelle.
Le DEM alt-ZERO propose d’entrelacer les pratiques de recherches en architecture :
– celles sur le projet / la conception / la création et leurs pratiques,
– celles par le projet / la conception / la création et leurs expérimentations,
– ou encore celles de la recherche-action, de la recherche par le projet, du projet par la recherche et leurs récits à venir.
Il favorise l’interdisciplinarité par les ateliers de projet et de recherche copilotés par deux enseignants-chercheurs rassemblant à eux deux les qualités suivantes :
- un enseignant-chercheur du champs TPCAU ou VT-UPU,
- un enseignant-chercheur d’un autre champs,
- un est architecte praticien,
- un est rattaché à une UR des ENSA.
Le stage obligatoire
Contact

Laure SALHEN
Stage de MAITRISE D’ŒUVRE ARCHITECTURALE en S7-S8 ou S9-S10 (8 crédits)
Objectif pédagogique : Le stage de formation pratique de 8 semaines minimum a pour objet, conformément au programme pédagogique de l’école, de donner à l’étudiant(e) des savoirs et des savoir-faire complémentaires à l’enseignement dispensé, lui permettre de confronter ses connaissances théoriques aux pratiques réelles de conception et réalisation d’édifices, de découvrir différents aspects de la maîtrise d’œuvre. Cette mise en situation professionnelle peut être réalisée à l’étranger.
Durée et période : La période du stage n’est pas fixée dans l’emploi du temps. Pendant le déroulement des stages , l’étudiant(e) peut solliciter son tuteur parcours. Le stage MOE correspond à minima à 280 heures (soit 8 semaines).
Stage COMPLÉMENTAIRE en S7-S8 ou S9-S10
Objectif pédagogique : Ce second stage d’environ 6 semaines consiste , conformément au programme pédagogique de l’école, en une mise en situation professionnelle complétant l’apport théorique de l’enseignement dispensé à l’école. Il a pour objet de permettre à l’étudiant(e) de mieux définir son propre projet en l’inscrivant dans une thématique choisie et dans le cadre d’un stage à l’étranger d’enrichir sa culture et d’acquérir des pratiques architecturales différentes. Ce stage peut être réalisé dans une autre structure liée aux thématiques de formation de l’ENSAM mais aussi dans une structure ayant pour objet la pratique architecturale ou maîtrise d’œuvre architecturale .
Durée et période : La période du stage n’est pas fixée dans l’emploi du temps. 2 à 3 jours sont libérés pour permettre des stages à temps partiels. Pendant le déroulement des stages, l’étudiant(e) peut solliciter son tuteur parcours.
Master en double cursus
Contact

Laure DELIGNE
L’association des Architectes Ingénieurs et Ingénieurs Architectes a été lancée en 2018 (association de loi 1901) pour créer des opportunités d’échanges entre praticiens, penseurs et acteurs des univers de l’architecture et de l’ingénierie. Elle rassemble aujourd’hui 200 membres adhérents, une communauté composée d’ingénieurs et architectes francophones, futurs ou anciens diplômés.
Ouverte à tous, l’association encourage le développement de compétences transversales entre ingénierie et architecture qui permettent dès aujourd’hui d’aborder au mieux les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques du XXIème siècle.
Pour plus de renseignements : AAIIA | Association Architecte-Ingénieur & Ingénieur-Architecte
Master Architecte Ingénieur ENSA Montpellier / École Nationale des Mines d’Alès
Le présent double cursus a pour objet de permettre aux étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier et l’École Nationale Supérieure des Mines d’Alès de suivre un parcours bi-diplômant organisé par les deux institutions.
Objectifs
- Favoriser l’apprentissage du projet architectural et urbain dans une dimension transculturelle architecturale et technique
- Mettre en place une démarche de complémentarité dans l’apprentissage des méthodes et des savoirs dans l’enseignement du projet architectural et urbain
- Favoriser et renforcer l’insertion professionnelle des futurs architectes-ingénieurs et ingénieurs-architectes.
Candidature
Les étudiants de l’ENSAM sont sélectionnés à la fin du semestre 5 du cycle Licence sur la base d’une lettre de motivation et d’un entretien de motivation permettant une mise à niveau.
Les pré-requis pour candidater sont d’avoir obtenu un baccalauréat scientifique ou effectué une prépa scientifique avant l’entrée à l’ENSAM.
À l’issue de la mise à niveau, un jury commun aux deux écoles auditionne les étudiants pour accéder au double cursus.
Master transitions numériques et environnementales en alternance
Formez-vous aux métiers de la construction durable et du management de projet BIM, et obtenez un Master du Cnam.
Objectifs
- Former des cadres techniques du bâtiment à la mise en œuvre du processus de conception et de gestion de projet numérique (Building Information Modeling ou BIM) au sein des entreprises de construction et des bureaux d’études
- Former à la prise en compte des enjeux de développement (construction et réhabilitation durables, réemploi et économie circulaire, performance énergétique et environnementale, …) et à l’intégration des nouvelles technologies et de leurs usages dans le bâtiment (bâtiment et ville intelligente, traitement des données…).
- Les diplômés exercent majoritairement la fonction de chef de projet. Ils doivent maîtriser un spectre large de compétences relatives à l’ingénierie du bâtiment durable et au management de projet en processus BIM. Cette large palette de compétences les destine à évoluer dans tous les métiers connexes (Chargé d’affaires, MO, AMO, MOE, ingénieur d’études TCE, ingénieur études de prix, ingénieur méthodes, manager de projet BIM, ingénieur travaux, contrôleur technique, responsable des services techniques, …).
Différents cursus
- Le cursus ouvert au Cnam Paris en partenariat avec le CFA Bâtiment Saint-Lambert vise spécifiquement l’insertion professionnelle dans les entreprises de construction et les bureaux d’études régionaux.
- Le cursus ouvert à Montpellier en partenariat avec l’école d’architecture (ENSA-M) vise une insertion professionnelle large chez les acteurs régionaux de la construction et de l’architecture
- Le cursus ouvert à Bordeaux en partenariat avec l’école d’architecture (ENSAP-B) vise une insertion professionnelle large chez les acteurs régionaux de la construction et de l’architecture.
- Le cursus ouvert à Cayenne en partenariat avec l’Université de Guyane (UG) vise une insertion professionnelle large et forme aux enjeux de la construction climat intertropical.
- Le cursus ouvert à Casablanca en partenariat avec l’école d’ingénieur HESTIM vise principalement une insertion professionnelle dans les métiers du BIM. Les candidatures se font directement au Cnam Maroc (Contact – Cnam Maroc)
Candidatures
L’accès au diplôme peut également se faire par le dispositif de la validation des études supérieures (VES) et de la validation des acquis professionnels (VAPP), en particulier pour les professionnels en exercice ou en reconversion professionnelle.
Renseignements et contact : btp.cnam.fr/alternance-fa-/master-genie-civil/